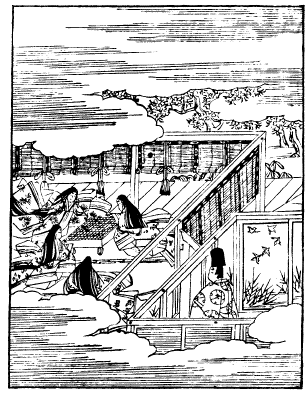La rivière aux
bambous
Ce qui suit est le récit que m’ont fait, sans s’en faire prier, certaines commères à la langue bien pendue qui avaient vécu dans l’entourage du précédent Grand Ministre, donc loin de la maison du Genji, et cela bien longtemps après les faits. Leur propos ne ressemblaient guère à ceux que m’avaient tenus les femmes de Murasaki, mais voici ce qu’elles m’ont affirmé :
— Dans ce que l’ont dit de la descendance du Genji, bien des erreurs se sont glissées ! Celles–là étaient bien plus vieilles que nous, et c’est de leur radotage sans doute que sont venues les erreurs !
Il reste donc un doute, mais qui sait où est la vérité ?
Du sein de la dame Régente du Service Intérieur, ce défunt Ministre avait eu trois fils et deux filles, et il avait pris toutes les dispositions pour leur donner l’éducation la plus soignée ; les ans et les mois s’étaient écoulés et l’heure tant attendue approchait, quand la mort vint décevoir ses espoirs, si bien qu’il fallut différer l’entrée des jeunes filles au service du Palais, qu ’il avait impatiemment rêvée. Or le monde ne flatte jamais que les puissants du moment ; si donc après la disparition d’un Ministre qui avait disposé d’un pouvoir redoutable, les biens et les domaines de sa famille ne s’en trouvaient nullement diminués, comme par un retournement soudain, sa résidence de jour en jour se faisait plus silencieuse. Les plus proches parents de la dame Régente s’étaient certes taillé une large place dans le monde, mais en revanche, ainsi qu’il arrive dans les familles de rang insigne, ils n’avaient jamais été sur un pied d’intimité, et de plus le feu Ministre, qui péchait quelque peu par manque de générosité, s’était pat son caractère trop versatile aliéné leur sympathie, si bien qu’il n’en était aucun à présent avec qui elle pût entretenir un commerce affectueux. A la résidence de la Sixième Avenue par contre, tout comme par le passé, on la comptait parmi les membres de la famille, et comme le défunt seigneur l’avait couchée sur son testament à la suite de l’Impératrice, le Ministre de la Droite, fidèle aux volontés de son père, allait lui rendre visite chaque fois qu’il se devait.
Les seigneurs ses fils avaient pris les habits virils, et l’un après l’autre atteint l’âge adulte ; mais si, après la disparition du ministre, leur position avait été parfois menacée, leur réussite n’en paraissait pas moins assurée à présent. Pour ses filles toutefois, elle se tourmentait, ne sachant trop ce qu’elle allait en faire. Le Ministre avait informé l’Empereur lui-même de son vif désir de les voir au service du palais, et celui-ci, estimant, d’après le décompte des ans et des mois, qu’elles devaient avoir atteint l’âge requis, avait mainte fois fait rappeler cette promesse, mais elle se disait que si elles devaient prendre rang après toutes celles qui, déjà, rejetées dans l’ombre par l’incomparable faveur dont jouissait l’Impératrice, semblaient réduites à rien, tout cela pour être regardées de haut et de travers par celle-ci, ce serait pour elles un sort bien déplorable, et que pour elle-même, ce serait un crève-cœur de les voir réduites à une position inférieure et méprisées ; pour toutes ce raisons donc, elle hésitait à déférer aux désirs de Sa Majesté. L’Empereur retiré du Reizei-in, de son côté, lui faisait des offres instantes, et il allait jusqu’à reprocher à la dame Régente sa propre cruauté, lorsqu’elle avait jadis repoussé ses avances :
Dussiez-vous toujours et à plus forte raison mépriser mon aspect suranné et décrépit, donnez-moi l’une de vos filles pour qui je serai, soyez-en persuadée, l’égal d’un père attentionné.
Quand il la pressait de la sorte, elle se demandait perplexe, ce qu’il pouvait en advenir ; elle-même par un coup du sort regrettable et imprévisible, s’était attiré sa disgrâce, à sa honte et confusion : allait-elle de cette façon, et pour le reste de ses jours, chercher à se rétablir à ses yeux ? Le bruit s’était répandu que ses filles étaient d’une très grande beauté, et nombreux étaient ceux qui déclaraient leur sentiment. Celui que l’on désignait par son titre de Capitaine Secrétaire, fils du Ministre de’ la Droite par la dame de la Troisième Avenue, que celui-ci tenait en plus haute estime que les seigneurs ses frères aînés, et qui du reste était un jeune homme d’un naturel fort aimable, leur faisait une cour assidue. Comme ils étaient ses proches parents par leur père et par leur mère, ces jeunes seigneurs avaient leurs entrées dans la maison où la dame les accueillait sans cérémonie. Il était de la sorte loisible à celui-là d’approcher ses femmes et de leur confier sa passion, si bien que la dame Régente finissait par être excédée par les louanges dont jour et nuit elles lui rebattaient les oreilles. La dame, mère du Capitaine, lui adressait elle aussi de fréquentes missives, et le Ministre de son côté lui disait :
— Il est certes d’un rang infime encore, mais je vous saurais gré de votre consentement !
Or, s’il n’entrait pas dans ses intentions de se résoudre à donner sa file aînée à un homme du commun, elle ne voyait aucun inconvénient par contre, à ce que le jeune homme briguât la main de la demoiselle seconde, lorsqu’il aurait acquis un peu plus de poids dans le monde.
Mais elle n’était pas sans redouter que si elle refusait son consentement, il ne vînt à séduire l’aînée. Non point qu’elle jugeât du tout pareille union mal assortie, mais à supposer que ce te accident de produisît sans l’aveu de la fille, l’on en jaserait et on la taxerait de légèreté, aussi prévint-elle les femmes qui transmettaient les lettres :
— Soyez sur vos gardes, et ne provoquez un malheur !
Elles se le tinrent pour dit et lui firent sentir qu’il les ennuyait.
…
*
Venue la troisième lune, à la saison de la splendeur des fleurs, épanouies sur tel cerisier, quand de tel autre déjà elles se dispersaient en un nuage, en ces lieux paisibles que rien ne vient troubler, il semblait que l’on pût, sans s’exposer au reproche, se tenir près du rebord. En ce temps-là, les demoiselles devaient être dans leur dix-huit ou dix-neuvième année, l’une et l’autre plaisantes de figure et de caractère.
L’aînée, aux traits réguliers, d’une grande noblesse et d’une nature enjouée, était si belle qu’en effet, il eût paru incongru qu’on la confiât aux soins d’un homme du commun. Vêtue, sous la robe étroite à traîne couleur cerisier, d’un ensemble fleur de corète, tout en elle, jusqu’au couleurs en harmonie avec la saison, paraissait déborder de séduction, cependant que son maintien, parfaitement contrôlé imposait le respect.
La cadette portait un ensemble prunier rouge pâle, sur lequel se déployait, en longues lignes flexibles comme les rameaux du saule, une chevelure opulente et lustrée ; mince et svelte, d’une élégance raffinée, elle l’emportait par le sérieux et la profondeur d’ esprit sur sa sœur qui toutefois était, de l’avis de leurs femmes, incomparable pour l’éclat de sa beauté. Assises face à face pour jouer au go, la retombée de chevelures composait un tableau superbe.
Le sire Chambellan se tenait près d’elles pour arbitrer la partie, quand les seigneurs ses frères aînés vinrent glisser un coup d’œil.
– Quel insigne honneur pour notre Chambellan ! Etre admis à arbitrer cette partie de go ! dirent-ils, et quand d’un air compassé, ils s’agenouillèrent, les femmes qui se trouvaient à l’entour rectifièrent leur tenue. Et comme le Commandant maugréait :
– Maintenant que le service du Palais me prend tout mon temps, celui-ci en profite pour m’évincer ! C’est exaspérant !
…
|
|
Après le départ du Commandant et des autres, les jeunes filles reprirent la partie de go interrompue. Pour enjeu, elles choisirent le cerisier qu’elles s’étaient autrefois disputé. – Les fleurs appartiendront à celle qui de trois parties en aura gagné deux ! fut-il convenu au terme d’un joyeux échange de propos badins. Comme l’intérieur était sombre, elles avaient, pour terminer, pris place près du rebord. On avait roulé les stores et les femmes, toutes, faisaient des vœux pour la victoire de leur maîtresse respective. Juste à ce moment-là, l’inévitable Capitaine était venu rendre visite au sire Chambellan, mais comme ce dernier était sorti avec ses frères, et qu’il avait trouvé la maison déserte, il s’approcha à pas de loup de la porte du couloir qui était restée ouverte et glissa un coup d’œil. Que pareille bonne fortune lui parût une rencontre heureuse autant que celle d’un bouddha qui eût daigné se montrer à ses yeux, voilà qui donnait la mesure de son égarement. La brume du soir gênait la vue, mais en regardant attentivement, il parvint à reconnaître l’aînée au dessin de la robe couleur cerisier. L’éclat en était si intense qu’en vérité il eût aimé « la voir encore en souvenir des fleurs après qu’elles seraient dispersées »,songea-t-il, et son dépit n’en fut que plus vif à la pensée qu’elle appartiendrait à un autre. Les silhouettes des jeunes femmes, qui se mouvaient sans contrainte dans la douce lumière du soleil couchant, offraient un spectacle plaisant. Ce fut celle de la droite, la cadette qui gagna. |
– Qu’est-ce qu’on attend pour exécuter le « tumulte de Koma » ? s’écria l’une des femmes.
Cet arbre, qui a toujours été du parti de la droite, puisqu’il se trouve planté devant les appartements de l’ouest, quelle idée de vouloir l’attribuer à la gauche ! Et voilà pourquoi on se querelle depuis des années ! jubilait-on du côté droit.
–
Le Capitaine n’y comprenait goutte, mais n’en prenait pas moins de plaisir à les écouter ; il eût certes aimé intervenir, mais il s’avisa à temps qu’il serait d’un goût déplorable de surprendre des femmes sans défiance, et il se retira. Il avança toutefois en longeant les cloisons, à l’affût d’une nouvelle aubaine de la sorte.
|
Le capitaine Kurôdo no shôshô aperçut à la dérobée les deux belles jeunes filles qui étaient absorbées dans une partie de Go, dont l’enjeu était le cerisier du jardin. |
|
Les jeunes personnes disputaient ainsi
de fleurs du matin au soir quand, à la tombée du jour, un vent violent se
déchaîna qui les dispersa toutes : au regret de les voir tomber, la
demoiselle qui avait été battue au jeu :
Quand souffle le vent
A cause du cerisier
Mon cœur est troublé
Alors que je sais pourtant
Combien ces fleurs sont ingrates
Et dame Saïsho, qui était de son parti, de venir à la rescousse :
On les croit à peine
Décloses que déjà ces fleurs
Se sont dispersées
Comment donc vous en vouloir
De nous en avoir privées
Lors la demoiselle de la droite :
De se disperser auvent
En ce monde est le sort commun
Mais je ne puis voir
Sans peine passer des fleurs
Dont les rameaux m’appartiennent
Et dame Taïfu, de son parti :
Ô fleurs qui au bord
De l’étang vous êtes tombées
Si vous êtes sensées
Fût-ce sous forme d’écume
Venez donc de ce côté
Une fillette du parti vainqueur était descendue dans le jardin et, se promenant sous les fleurs, elle en avait ramassé une pleine poignée qu’elle apporta à sa maîtresse :
Au vent du ciel
Elles se sont dispersées
Fleurs de cerisier
Mais puisqu’elles sont à nous
J’en ai ramassées pour voir
Ce dont la railla Nareki, de la gauche :
Pour les empêcher
De tomber ce merveilleuses
Fleurs de cerisier
Ta manche suffirait-elle
A toutes les recouvrir
Que voilà, ce me semble une façon bien étriquée, dit-elle.
Cependant qu’elles passaient de la sorte les mois et les jours à ces amusements futiles, la dame Régente, qui s’inquiétait de leur avenir, remuait mille pensées. De chez l’empereur retiré, jour après jour, venaient des lettres. Quant à l’Epouse Impériale :
- Serait-ce que vous sous méfiez de moi, pour ainsi me tenir à l’écart ? Sa Majesté s’imagine que je vous ai rebutée et semble m’en vouloir, si bien que ses reproches, fût-ce en manière de plaisanterie me blessent. Mieux vaudrait, à tant faire, vous décider sans tarder ! disait-elle le plus sérieusement du monde.
Genji Monogatari – Livre quarante-quatrième